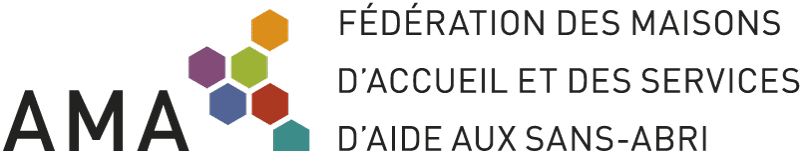Dans “Les Invisibles”, Louis-Julien Petit aborde l’exclusion par le biais de la comédie sociale. Inspiré par “The Full Monty”, il réussit à faire rire en racontant le quotidien d’un centre d’accueil pour femmes sans-abri. Dans un film fort où les professionnelles Audrey Lamy, Corinne Masiero ou Noémie Lvovsky côtoient de vraies SDF.
Le 5 octobre dernier, Les Invisibles faisait la clôture du 33 e Festival du film francophone de Namur. Quelques heures plus tôt, on rencontrait son auteur Louis-Julien Petit, réalisateur français un peu à contre-courant. À rebours de la production française classique, le jeune cinéaste de 35 ans s’est en effet spécialisé dans les thèmes sociaux. Son premier long, Discount en 2015, se passait dans le milieu de la grande distribution. L’année suivante, dans Carole Matthieu, téléfilm avec Isabelle Adjani produit par Arte , il évoquait la médecine du travail et le burn-out. Tandis que dans Les Invisibles , il décrit le quotidien d’un centre d’accueil de jour pour femmes sans-abri. « Le fil conducteur, c’est de faire des films sur des résistants modernes, sur une forme de désobéissance civile, des combats que les personnages croient juste mais qui frisent l’illégalité. Cette fois, j’ai voulu m’intéresser à des femmes cassées, à une micro-société que personne ne veut voir. Parce qu’on n’a pas envie de s’y reconnaître, qu’on a peur de tomber à la rue » , explique le réalisateur.
Ce qui surprend avec Les Invisibles, malgré son thème très dur, c’est la vie et la drôlerie qui se dégagent du film. « Durant une année d’investigation dans des centres d’accueil un peu partout en France, j’ai rencontré énormément de femmes qui sont pleines de vie, de peps, de force. De tragicomédie en fait. Mon premier scénario s’apparentait un peu trop à une chronique sociale. J’avais envie de tout dire, de tout montrer ; c’était trop premier degré. Or, leur bouclier, c’est l’humour, l’autodérision. Je me suis dit que c’était cela qui pourrait casser les appréhensions qu’on pouvait avoir sur ce sujet… », confie le réalisateur. Qui s’est finalement orienté vers une comédie sociale à l’anglaise (cf. ci-contre).
Mettre en scène le réel
Son film, Louis-Julien Petit l’ouvre sur un entretien entre une SDF et son assistante sociale, qui lui demande comment elle se retrouve à nouveau dans la rue, alors qu’elle était parvenue à lui trouver un appartement. « Le documentaire de Claire Lajeunie (NdlR : Femmes invisibles, dont s’est inspiré le cinéaste) se termine au moment où Catherine trouve une place dans un hôtel social. Mais quand j’ai commencé mes recherches, je l’ai retrouvée dans la rue. Je me suis demandé pourquoi la réinsertion était-elle si complexe. J’ai voulu réfléchir aux limites de l’aide qu’on peut apporter, à travers plusieurs personnages. »
Son film, Petit l’a nourri de ces scènes vues et de ses rencontres avec ces travailleuses sociales, notamment à L’Envol à Arras, qui a donné son nom au centre d’accueil de jour du film. « Cela a été complexe d’intégrer ces centres. Il a fallu beaucoup de mails, de discussions…, confie le réalisateur. Je ne voulais pas être voyeuriste ou adopter un regard misérabiliste. Elles m’ont toutes fait promettre de faire un film solaire et lumineux. Je crois que c’est un film de femmes mais sur l’Homme avec un grand H, sur les rapports humains, le vivre-ensemble. Si on élargit un peu le sujet, le film parle de gens qui, comme beaucoup de monde, ont besoin d’aide. Le chômage, la maladie, un divorce, une rupture… On a tous eu besoin d’aide à un moment, de retrouver confiance en soi, de l’estime de soi, de la cohésion sociale… »
De vraies femmes SDF
Pour écrire Les Invisibles, Louis-Julien Petit s’est inspiré des histoires recueillies auprès des femmes sans-abri. « Toutes les femmes du film, à 98 %, ont connu la rue. Elles ont mis leur histoire au service du film. On est allé dans les foyers et on a vu une centaine de femmes, qui nous ont parlé de leur vie. Je les ai toutes vues et c’est vraiment l’ascenseur émotionnel. Je ne cherchais pas des histoires mais des personnalités. »
Pour les préparer au tournage, le cinéaste a d’abord organisé une série d’ateliers, deux ou trois fois par semaine. « C’est là que je leur ai demandé de choisir un avatar, comme cela se fait dans les centres d’accueil pour préserver leur anonymat. Et elles sont devenues Lady Di, Mimi Mathy, Françoise Hardy… Elles sont devenues ces femmes qu’elles admirent. Et, pour l’équipe technique, elles le sont restées. Cela créait des scènes assez drôles, quand je disais par exemple : ‘Brigitte Macron, mets-toi à côté de Simone Veil.’ Le premier jour, j’étais persuadé que beaucoup ne viendraient pas, laisseraient tomber. Cela a été le cas pour certaines, mais les plus téméraires se sont donné un but : faire ce film. À la fin, j’ai compris que l’une d’entre elles faisait deux heures de stop tous les matins pour participer au film ! », se souvient le cinéaste.
Pour faciliter le travail de ces amatrices, Les Invisibles a été tourné dans la continuité. Tandis que Louis-Julien les a filmées sur le même plan que ses actrices professionnelles (Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky…). « Ce sont les actrices qui se sont mises au diapason. Tout le monde s’est adapté. On a tous été bouleversés par leur sensibilité. Il y a un lien qui s’est créé. Pour la scène du relooking, elles m’ont donné des photos d’elles, de leurs enfants. On voit dans leur regard qu’il se passe un truc, ça ne triche pas. Cela se passe beaucoup hors-champ. En tout cas, à chaque fin d’une grosse scène où elles étaient fortement impliquées, toute l’équipe technique les applaudissait… »
« On ne va pas à la rue par choix »
Les Invisibles résonne fortement avec la situation sociale actuelle en France. Quand Emmanuel Macron affirme à un chômeur qu’il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Ou quand, il y a un an, son secrétaire d’État en charge du Logement Julien Denormandie déclarait qu’il n’y avait qu’une cinquantaine de SDF en Île-de-France. Quelques semaines plus tard, les associations d’aide ont dénombré au moins 2 000 sans-abri à Paris. « Ce que je ne peux pas entendre, c’est qu’on va à la rue par choix . J’ai essayé de montrer la complexité des situations. Notamment à travers le personnage de Sarah Suco, qui est dans le déni d’être SDF, de l’aide dont elle a besoin et qu’elle refuse. C’est le personnage qui est peut-être le plus proche de notre quotidien. Je crois au cinéma qui pose un sujet de société qui fait débat. C’est à ce moment que le film devient politique. Mais il faut laisser au spectateur son libre arbitre pour réfléchir. Pour moi, c’est pas du cinéma militant, c’est du cinéma tout court », plaide Louis-Julien Petit. Tout en se réjouissant que, deux ans après la sortie de son film Discount en 2014, une loi soit passée en France contre le gaspillage alimentaire.
Autre écho troublant avec le réel, ces scènes d’évacuation musclées des SDF par la police. Des images dures qui font évidemment penser au démantèlement des camps de réfugiés à Calais, Paris ou Bruxelles. « J’ai assisté à cela à Stalingrad. L’image de la fourche dans le matelas, elle est sur Youtube. Putain, en 2018 à Paris !, s’insurge le réalisateur. On est en crise de l’humanitaire et elle n’est pas prête de s’arrêter. Autant s’intéresser aux acteurs associatifs qui luttent contre ça. Mais ce que j’aime dans cette scène de démantèlement, c’est que je ne voulais pas avoir l’incarnation du mal, d’un méchant. Moi, je crois plus à un monstre sans visage. On subit tous ce système-là. C’est important dans cette scène de se dire que tout le monde subit, celui qui démonte le camp, celui qui donne l’ordre… »
Ce qui compte avant tout pour le cinéaste avec ce film, c’est de rendre leur dignité à ces femmes, notamment dans une très belle scène finale, pleine de chaleur humaine… Cette dignité, le cinéaste l’a trouvée chez chacune des femmes qu’il a rencontrées. Notamment auprès de la très impressionnante Adolpha Van Meerhaeghe, qui a écrit un livre pour raconter son histoire de « sans-dents » et qui joue son propre rôle dans le film. « Elle sort de taule mais elle en est très fière, car c’est là qu’elle a tout appris de son métier. Elle a vraiment été en prison pendant 11 mois à Loos pour avoir tué son mari qui la battait… C’est sa vie et elle ne le cache pas. Lors d’un entretien d’embauche, elle préfère être franche, là où tout le monde aurait choisi de mentir. C’est là qu’elle m’épate : on ne passera pas en travers de sa dignité ! C’est là la leçon de vie… », conclut Louis-Julien Petit.